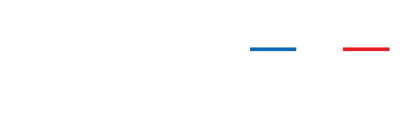Groupe cynothechnique
Éléments incontournables lorsque l’on parle de recherche de personnes, les unités cynotechniques ont permis, par la diversification de leurs techniques de travail, d'améliorer la recherche de personne lors des catastrophes de toutes natures et d'augmenter significativement le taux de chance de retrouver rapidement des personnes égarées ou incapables de répondre aux appels des sauveteurs.
Création des unités cynotechniques.
Dans les Yvelines, c'est en 1982, à l'initiative du colonel Janvier, directeur départemental de l’époque, que l'utilisation des chiens de recherche se met en place au sein des sapeurs-pompiers.
Encadré par le commandant Ratineau du centre de secours principal de Rambouillet, un petit groupe de passionnés se lance dans cette discipline où l'on forme ce que l'on nomme à l'époque des "équipes cynophiles de recherche et de sauvetage en décombres".
Il faudra attendre le début des années 90, pour qu’une seconde discipline, le pistage, trouve naturellement sa place dans cette spécialité. Très largement utilisée par d'autres unités civiles et militaires, elle est désormais intégrée au sein de l’unité. On distingue alors deux disciplines : le chien de recherche et de sauvetage en décombres et le chien de pistage.
Une nouvelle méthode de recherche dans les années 90
Vers la fin des années 90, le Centre National de formation du chien de secours de Briançon, met en place une nouvelle technique de recherche de personnes égarées : c’est la méthode de la queste.
Cette technique de recherche permet à des chiens, dressés spécialement, de localiser des personnes vivantes dans un périmètre donné, sans avoir d'odeur de référence. Le chien de questage, appelé aussi chien de recherche en surface, travaille sans odeur de référence (contrairement à son homologue le chien de pistage). Cette technique qui convient parfaitement aux chiens déjà formés en recherche de personnes ensevelies fait son entrée dans la spécialité.
L’arrivée d’un guide national de référence en 2000 modifie complètement la spécialité et voit l’apparition d’une nouvelle dénomination : la cynotechnie. Chez les sapeurs-pompiers des Yvelines c’est l'adjudant-chef Boulesteix, du centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye, alors moniteur à Briançon, qui devient responsable du groupe cynotechnique du Sdis78.
Avec ce nouveau guide national de référence, les appellations changent également. Les maîtres-chiens deviennent désormais des conducteurs cynotechniques et les équipes cynophiles prennent logiquement le nom d’équipes cynotechniques. Les équipes uniquement orientées sur le pistage disparaissent au fur et à mesure de la mise à la retraite des chiens et il ne reste aujourd'hui que des chiens formés à la recherche de personnes ensevelies et la recherche de personnes égarées par la méthode de la queste.
Changement d’appellation mais missions identiques
Le groupe cynotechnique du Sdis 78 prend également le nom d'Unité CYNO78.
Aujourd'hui, la spécialité est composée de 9 binômes et 10 chiens parmi lesquels des chefs de section cynotechnique, des chefs d'unité cynotechnique, des conducteurs cynotechniques et des stagiaires en cours de formation. Ensemble ils assurent une trentaine d’interventions par an et peuvent être déployés à l’international dans le cadre de l’aide internationale au sein d’un détachement INSARAG.
Aujourd’hui avec le guide des techniques opérationnelles CYNO nous avons la possibilité de former des chiens au pistage, à la recherche de victime immergé (RVIM) ainsi qu'à la recherche de produits accélérateurs d'incendie (RPAI).
Retrouvez ci-dessous la vidéo "Au cœur de l'action avec les équipes cynotechniques".
Les cookies fonctionnels doivent être autorisés pour afficher cette vidéo.