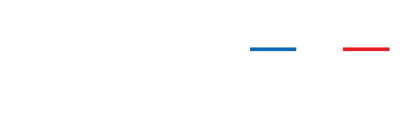Cellule mobile d'intervention radiologique
La Cellule Mobile d'Intervention Radiologique (CMIR) est une équipe des sapeurs-pompiers des Yvelines spécialisée dans la gestion des risques liés aux substances radioactives.
L’origine de cette équipe remonte aux années 80. C’est le lieutenant Jean-Valentin Schmitt, du corps de sapeurs-pompiers de Versailles, spécialiste particulièrement investit dans la formation des équipes « N » (Nucléaire), qui a posé les fondements de cette unité.
Au fil des années, l'équipe s'est développée pour devenir aujourd’hui une unité reconnue. Pionnière dans le déploiement opérationnel de la spectrométrie gamma, elle poursuit son investissement dans ce domaine et partage son expérience au sein de notre école nationale et au profit d’autres unités.
L’unité entretien de nombreux contacts avec les équipes spécialisées de la zone de défense et au-delà mais également avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et avec l’unité spécialisée de la Gendarmerie Nationale. Nos formations s’attachent à l’ouverture vers l’extérieur.
Elle est constituée de 75 spécialistes, parmi lesquelles des conseillers techniques, des chefs d’unité, des chefs d'équipe et équipiers d’intervention
Formée à la gestion de toutes les situations d'urgence, elle intègre depuis 2003, la prise en compte de la problématique de l'acte malveillant dans le cadre du plan NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) en collaboration avec la cellule mobobile risque chimique.